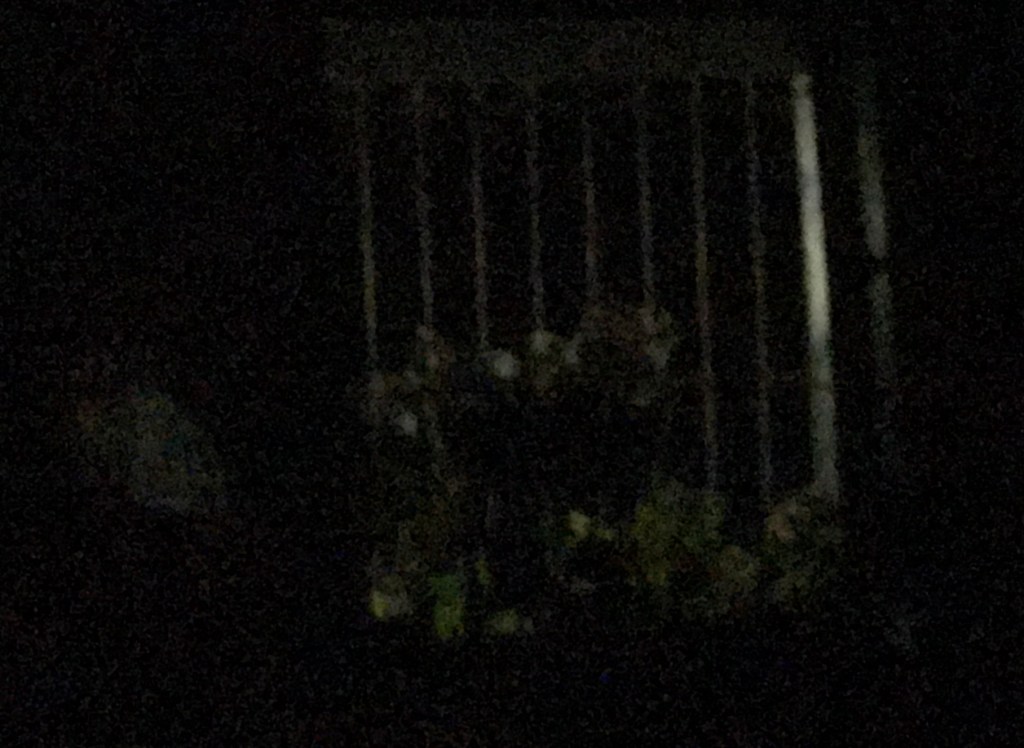
1h30. Tirée du sommeil par des hurlements dans le parc devant chez moi. L’un des jeunes répète “Fils de pute ! Fils de pute !” en alternance avec “J’m’en bats les couilles ! J’m’en bats les couilles !” Sa voix s’éraille à force de scander ces deux couplets en alternance. Appeler les gendarmes ? Une perte de temps.
C’est vraiment la plaie en été, lorsqu’il faut garder la fenêtre ouverte la nuit pour capturer un peu de fraîcheur, et qu’ils viennent régler leurs différends le long de la rivière.
Zahra, hier midi, avec l’histoire du voisin vendeur de haschich. Les va-et-vient constants la nuit, “le jour, ils dorment. Les gendarmes viennent jamais.” Sauf pour la fois où chez une autre voisine, la mère en train de regarder la télé a aperçu son fils en train de faire les poches de son père endormi, l’a photographié avec son téléphone, et a appelé les gendarmes. Cette fois-là, ils sont venus. Le père, réveillé, a encaissé le coup “même à vingt mètres, tu t’approches plus de moi” qu’il a dit à son fils qui habite maintenant dans l’autre complexe de HLM de l’autre côté de la ville.
Le leit-motiv de Zahra ? “C’est comme ça.” Mariée à 15 ans, enfermée à clé dans la cuisine avec un seau dans lequel faire ses besoins – sauf les samedis et les dimanches où, sous sa surveillance, le mari la faisait bosser dans le jardin.
Il est 2h30. Les hurlements s’estompent, se poursuivent plus loin de long de la rivière. Au moins, ils ne joueront pas du couteau devant chez-moi, cette fois. (Résultat de l’appel aux forces de l’ordre, cette fois-là ? “Combien sont-ils ?” et “Assurez-vous qu’ils ne vous voient pas.” Merci du peu, c’est le cas de le dire.)
J’aimerais bien dormir. Ça sera pour une autre fois. À 3h, ils reviennent. Les hurlements reprennent, cette fois, le tout se soldera par … cris et fureurs au sujet de je ne sais quoi.
*
Histoire de Sonetchka (Marina Tsvétaïéva) – Je ne ressens même pas l’ombre d’une affinité avec les extravagances hystériques de Sophie Evguénievna Holliday (Sonetchka) qui lui font dire des énormités comme : « Oh ! Marina, comme j’aime avoir mal ! Même simplement mal à la tête ! Le mal aux dents – je ne connais pas, je n’ai jamais eu mal aux dents, et parfois je suis prête à pleurer de ne jamais avoir eu mal aux dents, on dit que c’est un mal magnifique, telle-ment…lanci-n-an-ant ! »
Non mais…ça va pas la tête ? Aimer la douleur, qu’elle soit physique ou morale ? C’est quoi, une horreur pareille ? Je déteste la douleur, je la supporte, évidemment, quand elle est inévitable, mais l’aimer ???
Je ne comprends pas grand chose à cette histoire d’un amour tout en paroles excessives, démesurées, cherchant désespérément à s’élever au-dessus du quotidien abject de la Russie en 1919.
Dans le récit qu’elle en fait, Marina Tsvétaïéva semble éprouver une forme de nostalgie pour cette forme d’idolatrie dont elle fit l’objet par la jeune élève-actrice du IIe Studio. Un besoin aussi désespéré, aussi lanci-n-an-ant de reconnaissance me laisse un sentiment de grande tristesse. C’était en 1919, avant son départ de la Russie en 1922 et les années de solitude extrême. Il s’agirait de la dernière oeuvre en prose qu’elle ait écrite. *
*Marina Tsvétaïéva, Histoire de Sonetchka, traduit du russe par Véronique Lossky, éditions Clémence Hiver 1991 (En tant qu’objet, le livre est très beau.)
*
4h27 Deux vieux arabes traversent la passerelle depuis l’autre versant de la rivière, causant et s’éclairant avec des lampes de poche. Le chat se réveille. Son de l’eau qu’elle lappe dans son bol. Rêves et sommeil seront pour plus tard, du moins, je l’espère. Révisions et écritures aussi.